- Mise en forme JVCode
- Afficher les avatars
- Afficher les signatures
- Afficher les spoilers
- Miniatures Noelshack
Sujet : Nietzsche se contredit là non ?
À mesure que s’accroît sa puissance, une communauté accorde moins d’importance aux manquements de ses membres, puisque ces membres ne lui paraissent plus ni dangereux pour l’existence de l’ensemble ni subversifs dans la même mesure : le malfaiteur n’est plus chassé et « privé de la paix », le courroux général ne peut plus, comme jadis, se donner libre carrière contre lui, bien plus, on défend maintenant soigneusement le malfaiteur contre cette colère, on le protège surtout contre ceux qui ont subi le dommage immédiat. Le compromis avec la colère de ceux qui ont tout d’abord souffert du méfait ; l’effort tenté pour localiser le cas et obvier ainsi à une effervescence, à un trouble plus grand ou même général ; la recherche d’équivalents pour accommoder toute l’affaire (la compositio) ; avant tout la volonté toujours plus arrêtée de considérer toute infraction comme pouvant être expiée, et par conséquent d’isoler, du moins dans une certaine mesure, le délinquant de son délit, tels sont les traits qui caractérisent toujours plus clairement le droit pénal dans les phases subséquentes de son développement. Si la puissance et la conscience individuelle s’accroissent dans une communauté, le droit pénal toujours s’adoucira ; dès qu’un affaiblissement ou un danger profond se manifestent, aussitôt les formes plus rigoureuses de la pénalité reparaissent. Le « créancier » s’est toujours humanisé dans la même proportion qu’il s’est enrichi ; en fin de compte, on mesure même sa richesse au nombre de préjudices qu’il peut supporter sans en souffrir. Il n’est pas impossible de concevoir une société ayant conscience de sa puissance au point de se payer le luxe suprême de laisser impuni celui qui l’a lésée. « Que m’importent en somme mes parasites ? pourrait-elle dire alors. Qu’ils vivent et qu’ils prospèrent ; je suis assez forte pour ne pas m’inquiéter d’eux ! »… La justice qui a commencé par dire : « tout peut être payé, tout doit être payé », est une justice qui finit par fermer les yeux et par laisser courir celui qui est insolvable, elle finit, comme toute chose excellente en ce monde, par se détruire elle-même. Cette autodestruction de la justice, on sait de quel beau nom elle se pare, elle s’appelle la grâce ; elle demeure, comme l’on pense, le privilège des plus puissants, mieux encore son « au-delà » de la justice.
https://fr.wikisource.org/wiki/La_G%C3%A9n%C3%A9alogie_de_la_morale/Texte_entier
Tant que l’utilité dominante dans les appréciations de valeur morale était seule l’utilité pour le troupeau, tant que le regard était uniquement tourné vers le maintien de la communauté, que l’on trouvait l’immoralité, exactement et exclusivement, dans ce qui paraissait dangereux à l’existence de la communauté, il ne pouvait pas y avoir de « morale altruiste ». Admettons que, même alors, il existait un usage constant dans les petits égards, dans la pitié, l’équité, la douceur, la réciprocité et l’aide mutuelle ; admettons que, dans cet état de la société, tous ces instincts que l’on honorera plus tard sous le nom de « vertus » et que l’on finit par identifier presque avec l’idée de « moralité » étaient déjà en pleine action, néanmoins, à cette époque, ils n’appartenaient pas encore au domaine des appréciations morales, ils étaient encore en dehors de la morale. Un acte de pitié, par exemple, à l’époque florissante des Romains, n’était appelé ni bon, ni mauvais, ni moral, ni immoral ; et, quand même on l’aurait loué, cet éloge se serait mieux accordé avec une sorte de dépréciation involontaire, dès que l’on aurait comparé avec lui un acte qui servait au progrès du bien public, de la res publica. Enfin « l’amour du prochain » restait toujours quelque chose de secondaire, de conventionnel en partie, quelque chose de presque arbitraire si on le comparait à la crainte du prochain. Lorsque la structure de la société parut solidement établie dans son ensemble, assurée contre les dangers extérieurs, ce fut cette crainte du prochain qui créa de nouvelles perspectives d’appréciations morales. Certains instincts forts et dangereux, tels que l’esprit d’entreprise, la folle témérité, l’esprit de vengeance, l’astuce, la rapacité, l’ambition, qui jusqu’à ce moment, au point de vue de l’utilité publique, n’avaient pas seulement été honorés, bien entendu sous d’autres noms, mais qu’il était nécessaire de fortifier et de nourrir parce que l’on avait constamment besoin d’eux dans le péril commun, contre les ennemis communs, ces instincts ne sont plus considérés dès lors que par leur double côté dangereux, maintenant que les canaux de dérivation manquent pour eux, et peu à peu on se met à les marquer de flétrissure, à les appeler immoraux, on les abandonne à la calomnie. Maintenant les instincts et les penchants contraires ont la suprématie en morale, et l’instinct de troupeau tire progressivement ses conséquences. Quelle est la quantité de danger pour la communauté et pour l’égalité que contient une opinion, un état, un sentiment, une volonté, une prédisposition ? C’est la perspective morale que l’on envisage maintenant. Mais là encore la crainte est la mère de la morale. Ce sont les instincts les plus élevés, les plus forts, quand ils se manifestent avec emportement, qui poussent l’individu en dehors et bien au-dessus de la moyenne et des bas fonds de la conscience du troupeau, qui font périr la notion d’autonomie dans la communauté, et détruisent chez celle-ci la foi en elle-même, ce que l’on peut appeler son épine dorsale. Voilà pourquoi ce seront ces instincts que l’on flétrira et que l’on calomniera le plus. L’intellectualité supérieure et indépendante, la volonté de solitude, la grande raison apparaissent déjà comme des dangers ; tout ce qui élève l’individu au-dessus du troupeau, tout ce qui fait peur au prochain s’appelle dès lors méchant. L’esprit tolérant, modeste, soumis, égalitaire, qui possède des désirs mesurés et médiocres, se fait un renom et parvient à des honneurs moraux. Enfin, dans les conditions très pacifiques, l’occasion se fait de plus en plus rare, de même que la nécessité qui impose au sentiment la sévérité et la dureté ; et, dès lors, la moindre sévérité, même en justice, commence à troubler la conscience. Une noblesse hautaine et sévère, le sentiment de la responsabilité de soi, viennent presque à blesser et provoquent la méfiance. L’« agneau », mieux encore le « mouton » gagnent en considération. Il y a un point de faiblesse maladive et d’affadissement dans l’histoire de la société, où elle prend parti même pour son ennemi, pour le criminel, et cela sérieusement et honnêtement. Punir lui semble parfois injuste ; il est certain que l’idée de « punition » et « d’obligation de punir » lui fait mal et l’effraye. « Ne suffit-il pas de rendre le criminel incapable de nuire ? Pourquoi punir ? Punir même est terrible ! » Par cette question la morale de troupeau, la morale de la crainte tire sa dernière conséquence. En admettant d’ailleurs qu’on pût supprimer le danger, le motif de craindre, on aurait en même temps supprimé cette morale : elle ne se considérerait plus elle-même comme nécessaire ! Celui qui examine la conscience de l’Européen d’aujourd’hui trouvera toujours à tirer des mille replis et des mille cachettes morales le même impératif, l’impératif de la terreur du troupeau. « Nous voulons qu’à un moment donné il n’y ait rien à craindre ! » À un moment donné ! la volonté, le chemin qui y mène, s’appelle aujourd’hui dans toute l’Europe « progrès ».
https://fr.wikisource.org/wiki/Par_del%C3%A0_le_bien_et_le_mal/Chapitre_V._Histoire_naturelle_de_la_morale
En quoi se contredit-il ? Je lis deux fois une idée similaire avec des développements et un objet légèrement différents
Le 08 mai 2024 à 17:14:44 :
En quoi se contredit-il ? Je lis deux fois une idée similaire avec des développements et un objet légèrement différents
Enfin, dans les conditions très pacifiques, l’occasion se fait de plus en plus rare, de même que la nécessité qui impose au sentiment la sévérité et la dureté ; et, dès lors, la moindre sévérité, même en justice, commence à troubler la conscience. Une noblesse hautaine et sévère, le sentiment de la responsabilité de soi, viennent presque à blesser et provoquent la méfiance. L’« agneau », mieux encore le « mouton » gagnent en considération. Il y a un point de faiblesse maladive et d’affadissement dans l’histoire de la société, où elle prend parti même pour son ennemi, pour le criminel, et cela sérieusement et honnêtement. Punir lui semble parfois injuste ; il est certain que l’idée de « punition » et « d’obligation de punir » lui fait mal et l’effraye. « Ne suffit-il pas de rendre le criminel incapable de nuire ? Pourquoi punir ? Punir même est terrible ! » Par cette question la morale de troupeau, la morale de la crainte tire sa dernière conséquence.
À mesure que s’accroît sa puissance, une communauté accorde moins d’importance aux manquements de ses membres, puisque ces membres ne lui paraissent plus ni dangereux pour l’existence de l’ensemble ni subversifs dans la même mesure : le malfaiteur n’est plus chassé et « privé de la paix », le courroux général ne peut plus, comme jadis, se donner libre carrière contre lui, bien plus, on défend maintenant soigneusement le malfaiteur contre cette colère, on le protège surtout contre ceux qui ont subi le dommage immédiat.
Il n’est pas impossible de concevoir une société ayant conscience de sa puissance au point de se payer le luxe suprême de laisser impuni celui qui l’a lésée. « Que m’importent en somme mes parasites ? pourrait-elle dire alors. Qu’ils vivent et qu’ils prospèrent ; je suis assez forte pour ne pas m’inquiéter d’eux ! »…
Ben du coup c'est un truc de faible de punir ou de ne pas punir ![]()
L'accroissement de la force d'une communauté est distincte de celle des hommes qui la composent.
A moins bien sûr qu'il reste une différence entre la mansuétude des puissants et la mansuétude des faibles qui vient de l'impuissance... Mais bon, toujours du mal à le ranger quelque part l'ami Fredo 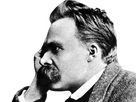
Ben du coup c'est un truc de faible de punir ou de ne pas punir
Il souligne plutôt les conséquences sociales et psychologiques de ces choix.
Dans ton premier paragraphe, il critique une société qui devient trop tolérante envers les comportements criminels, ce qu'il perçoit comme une manifestation de faiblesse morale. Il suggère que cette tolérance excessive découle d'une crainte de punir et de la perte de fermeté morale. Dans le second, il imagine une société puissante qui peut se permettre de ne pas punir les transgresseurs, car elle ne se sent pas menacée par eux. Il ne condamne pas nécessairement cette attitude, mais plutôt la considère comme une évolution possible dans une société où la sécurité est assurée. Bref, selon Nietzsche, les trucs de punir ou ne pas punir ne sont pas simplement des questions de force ou de faiblesse, mais plutôt des manifestations de différentes dynamiques sociales et psychologiques dans une société donnée.
pour moi c'est un texte en réalité qui porte sur la question du bien ou du mal chère a Nietzsche car il est question de l'ampleur des conséquences du délit en fonction du niveau de puissance de l'organisation et par projection de la considération du mal qui s'estompe à mesure que la puissance se révèle.
Ah tiens, maintenant on peut parler librement de Nietzsche sur jeuxvideo.com sans se faire définitivement bannir à cause d"accusations calomnieuses de pleureuses offusquées pour un rien... ![]()
Deuxième texte :
Lorsque la structure de la société parut solidement établie dans son ensemble, assurée contre les dangers extérieurs, ce fut cette crainte du prochain qui créa de nouvelles perspectives d’appréciations morales.
[...]
Car avant cela, il l'explique avant et après : il y avait une morale forte, du fort, pour progresser.
Mais alors, finalement, quand la communauté est établie et en paix :
Quelle est la quantité de danger pour la communauté et pour l’égalité que contient une opinion, un état, un sentiment, une volonté, une prédisposition ? C’est la perspective morale que l’on envisage maintenant. Mais là encore la crainte est la mère de la morale. Ce sont les instincts les plus élevés, les plus forts, quand ils se manifestent avec emportement, qui poussent l’individu en dehors et bien au-dessus de la moyenne et des bas fonds de la conscience du troupeau, qui font périr la notion d’autonomie dans la communauté, et détruisent chez celle-ci la foi en elle-même, ce que l’on peut appeler son épine dorsale. Voilà pourquoi ce seront ces instincts que l’on flétrira et que l’on calomniera le plus.
Donc on est passé de (voir avant) :
Certains instincts forts et dangereux, tels que l’esprit d’entreprise, la folle témérité, l’esprit de vengeance, l’astuce, la rapacité, l’ambition, [...] qu’il était nécessaire de fortifier et de nourrir parce que l’on avait constamment besoin d’eux dans le péril commun,
à cela (ici) :
L’esprit tolérant, modeste, soumis, égalitaire, qui possède des désirs mesurés et médiocres, se fait un renom et parvient à des honneurs moraux.
Ouais enfin c'est clair comme de l'eau de roche après.
Bon beh merci, ça m'a permis de voir qu'en effet Nietzsche avait eu de bonnes visions et parfois des perspectives bien au-delà (du bien et du mal) mais qu'en même temps, on voit ici qu'il n'avait pas forcément compris et intégré qu'il était possible d'avoir un monde "compétitif et vers plus de puissance" et un monde bienveillant, etc.
C'est par exemple la philosophie libérale en politique : chacun mène sa vie et sa barque et s'améliore dans ce qui lui semble bon et en même temps est moral et n'oublie pas (forcément) d'aider son prochain et d'agir en bien (car il ne peut rien gagner en agissant en mal : c'est même puni par la morale libérale : je ne peux pas faire de mal, comme voler(, etc. la propriété d')autrui.)
http://palimpsestes.fr/textes_philo/deleuze/Actif-et-reactif.pdf
Pour toutes ces raisons, Nietzsche peut dire : la volonté de puissance n’est pas seulement ce qui interprète, mais ce qui évalue [49] . Interpréter, c’est déterminer la force qui donne un sens à la chose. Évaluer, c’est déterminer la volonté de puissance qui donne à la chose une valeur. Les valeurs ne se laissent donc pas plus abstraire du point de vue d’où elles tirent leur valeur que le sens, du point de vue d’où il tire sa signification. La volonté de puissance comme élément généalogique est ce dont dérivent la signification du sens et la valeur des valeurs. C’est elle dont nous parlions sans l’avoir nommée, au début du chapitre précédent. La signification d’un sens consiste dans la qualité de la force qui s’exprime dans la chose : cette force est-elle active ou réactive, et de quelle nuance ? La valeur d’une valeur consiste dans la qualité de la volonté de puissance qui s’exprime dans la chose correspondante : la volonté de puissance est-elle ici afirmative ou négative, et de quelle nuance ? L’art de la philosophie se trouve d’autant plus compliqué que ces problèmes d’interprétation et d’évaluation se renvoient l’un à l’autre, se prolongent l’un l’autre. Ce que Nietzsche appelle noble, haut, maître, c’est tantôt la force active, tantôt la volonté affirmative. Ce qu’il appelle bas, vil, esclave, c’est tantôt la force réactive, tantôt la volonté négative.
Pourquoi ces termes, là encore nous le comprendrons plus tard. Mais une valeur a toujours une généalogie, dont dépendent la noblesse ou la bassesse de ce qu’elle nous invite à croire, à sentir et à penser. Quelle bassesse peut trouver son expression dans une valeur, quelle noblesse dans une autre, seul le généalogiste est apte à le découvrir, parce qu’il sait manier l’élément différentiel : il est le maître de la critique des valeurs [50] . Nous ôtons tout sens à la notion de valeur tant que nous ne voyons pas dans les valeurs autant de réceptacles qu’il faut percer, de statues qu’il faut briser pour trouver ce qu’elles contiennent, le plus noble ou le plus bas. Comme les membres épars de Dionysos, seules se reforment les statues de noblesse. Parler de la noblesse des valeurs en général témoigne d’une pensée qui a trop d’intérêt à cacher sa propre bassesse : comme si des valeurs entières n’avaient pas pour sens, et précisément pour valeur, de servir de refuge et de manifestation à tout ce qui est bas, vil, esclave. Nietzsche créateur de la philosophie des valeurs aurait vu, s’il avait vécu plus longtemps, la notion la plus critique servir et tourner au conformisme idéologique le plus plat, le plus bas ; les coups de marteau de la philosophie des valeurs devenir des coups d’encensoir ; la polémique et l’agressivité, remplacées par le ressentiment, gardien pointilleux de l’ordre établi, chien des valeurs en cours ; la généalogie, prise en main par les esclaves : l’oubli des qualités, l’oubli des origines [51].
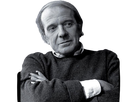
À l’origine, il y a la diférence des forces actives et réactives. L’action et la réaction ne sont pas dans un rapport de succession, mais de coexistence dans l’origine ellemême. Aussi bien la complicité des forces actives et de l’affirmation, des forces réactives et de la négation se révèle dans le principe : le négatif est déjà tout entier du côté de la réaction. Inversement, seule la force active s’affirme, elle affirme sa différence, elle fait de sa différence un objet de jouissance et d’affirmation. La force réactive, même quand elle obéit, limite la force active, lui impose des limitations et des restrictions partielles, est déjà possédée par l’esprit du négatif [52] . C’est pourquoi l’origine elle-même comporte, en quelque manière, une image inversée de soi : vu du côté des forces réactives, l’élément différentiel généalogique apparaît à l’envers, la différence est devenue négation, l’affirmation est devenue contradiction.
Une image renversée de l’origine accompagne l’origine : ce qui est « oui » du point de vue des forces actives devient « non » du point de vue des forces réactives, ce qui est affirmation de soi devient négation de l’autre. C’est ce que Nietzsche appelle « le renversement du coup d’œil appréciateur [53]». Les forces actives sont nobles ; mais elles se trouvent elles-mêmes devant une image plébéienne, réfléchie par les forces réactives. La généalogie est l’art de la différence ou de la distinction, l’art de la noblesse ; mais elle se voit à l’envers dans le miroir des forces réactives. Son image apparaît alors comme celle d’une « évolution ». Et cette évolution, on la comprend, tantôt à l’allemande, comme une évolution dialectique et hégélienne, comme le
développement de la contradiction ; tantôt à l’anglaise, comme une dérivation utilitaire, comme le développement du bénéfice et de l’intérêt. Mais toujours la vraie généalogie trouve sa caricature dans l’image qu’en donne l’évolutionnisme, essentiellement réactif : anglais ou allemand, l’évolutionnisme est l’image réactive de la généalogie [54]. Ainsi, c’est le propre des forces réactives de nier dès l’origine la
différence qui les constitue dans l’origine, de renverser l’élément diférentiel dont elles dérivent, d’en donner une image déformée. « Différence engendre haine [55]. »
C’est pour cette raison qu’elles ne se comprennent pas elles-mêmes comme des forces, et préfèrent se retourner contre soi plutôt que de se comprendre comme telles et d’accepter la différence. La « médiocrité » de pensée que Nietzsche dénonce renvoie toujours à la manie d’interpréter ou d’évaluer les phénomènes à partir de forces réactives, chaque espèce de pensée nationale choisissant les siennes. Mais cette manie elle-même a son origine dans l’origine, dans l’image renversée. La conscience et les consciences, simple grossissement de cette image réactive…